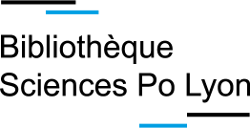| Titre | Combien coûte une chanson ? La culture du prix et le prix de la culture | |
|---|---|---|
| Auteur | Carlos Fausto | |
 |
Revue | Gradhiva : revue d'anthropologie et de muséologie |
| Numéro | no 31, 2020 L'idéal du musicien et l'âpreté du monde | |
| Rubrique / Thématique | Traductions inédites |
|
| Page | 130-142 | |
| Résumé |
Le texte présenté ici traite d'une question – à qui appartient la culture, et de quelle nature est cette « propriété » ? – que Gradhiva a déjà abordée à plusieurs reprises, notamment dans le dossier de son numéro 12 intitulé La Musique n'a pas d'auteur paru en 2010 et coordonné par Christine Guillebaud, Julien Mallet et Victor A. Stoichita.À partir des données collectées chez les Kuikuro dans le sud de l'Amazonie brésilienne, Carlos Fausto, professeur à l'Université Fédérale de Rio de Janeiro et directeur de recherche au CNPq, dresse dans l'article traduit ici un tableau des formes de commerce pratiquées dans cette aire indigène. Les Kuikuro – un groupe de langue carib formant l'une des composantes de l'ensemble pluriethnique du Xingu – se distinguent par une pratique intensive de l'échange inter et intra-tribal, toujours assortie de paiement immédiat, soit en biens de prestige tels que des ceintures de perles ou de coquillages, soit en monnaie nationale. Chez eux, tout, ou presque tout, se « vend » et se rétribue. Voilà qui sonne familier. Dans ce régime de valeurs cependant, le prix d'un objet – tangible ou intangible – se calcule en fonction de la valeur des relations qu'il permet de créer ou dont il est l'expression : ici, on désire du lien, non des biens. Chez les Kuikuro, la maîtrise des chants rituels est source de grand prestige, et leur transmission a un prix. Celle-ci impliquait jadis un contrat bien étrange entre maître et apprenti : chacun devait promettre de « tromper » l'autre. C'était une manière de conjurer par antiphrase le risque d'une interprétation erronée et de contraindre l'apprenti à « rentabiliser » son investissement en le transmettant à son tour. Cette « vente » d'un chant suppose une grande confiance entre partenaires. Pour cette raison, la transmission se fait entre proches parents et l'expertise reste l'apanage de certaines familles.Mais avec l'avènement des cassettes audio, les jeunes apprennent par eux-mêmes, sans avoir à rémunérer un maître. Cette banalisation entraîne aussitôt une forte dépréciation du répertoire et des maîtres qui le portent. Pour conjurer la disparition progressive des chanteurs de tradition, capables de mémoriser des centaines de pièces à la lettre et à la note près, le chef kuikuro et l'anthropologue Carlos Fausto lancent un projet d'archivage digital du corpus rituel. Cela crée deux difficultés. La première est de trouver un standard de paiement par chant qui soit accepté par tous les maîtres. La seconde est de savoir à qui appartient ce corpus enregistré. À tout le groupe, disait le chef, ce qui voulait dire, à lui-même. Et qui pourrait alors y avoir accès, sinon lui ? Les copies seraient confiées au musée de l'Indien à Rio et au centre kuikuro de documentation. Mais en « muséifiant » la tradition on signait sa mort. Il fallait donc la rendre accessible, dans les termes de la tradition : à chaque écoute de ces enregistrements, un paiement serait attribué au possesseur de ces chants.Cette gestion du copyright est le prix que les Kuikuro continuent d'accorder à la relation instaurée entre maître et apprenti comme à la capacité à la créer, un signe que la tradition et le régime de valeur dans lequel elle s'inscrivait résistent à leur dissolution promise dans un marché monétarisé. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
|
| Article en ligne | http://journals.openedition.org/gradhiva/5116 |